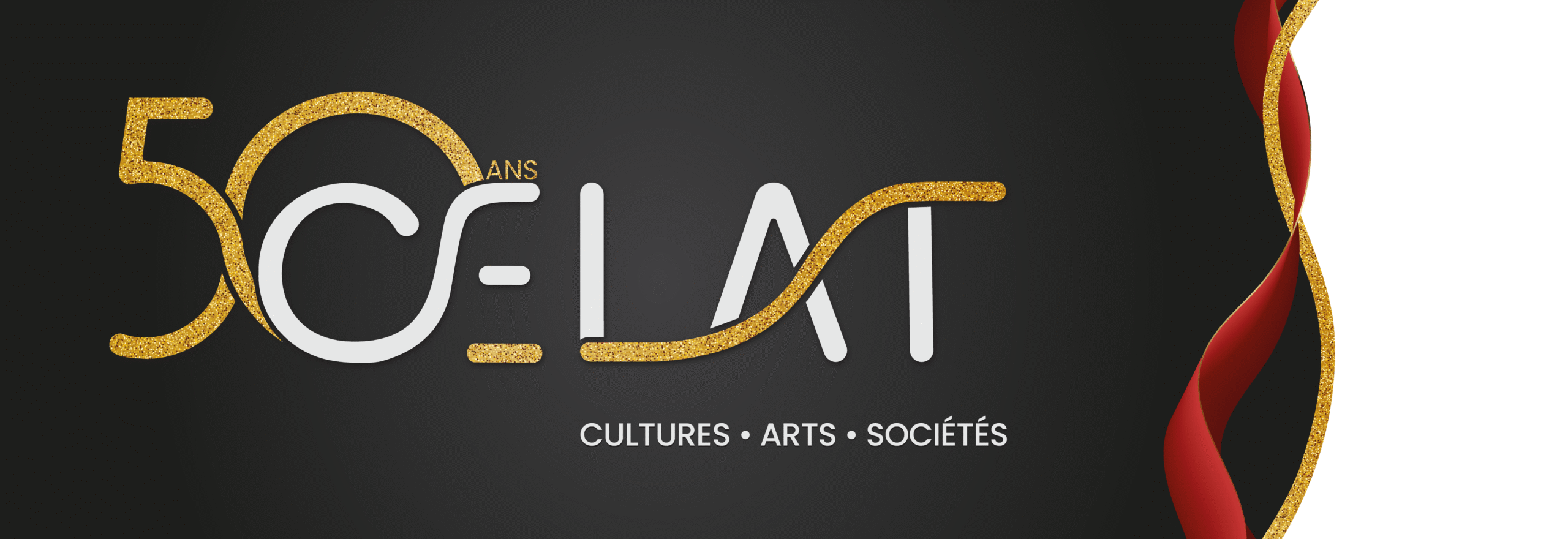Nous avons le grand plaisir de vous inviter au colloque marquant le 40e anniversaire de l’inscription de l’arrondissement historique du Vieux-Québec sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Organisé conjointement par la Ville de Québec, l’Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM), la Société historique de Québec et l’Institut du patrimoine culturel (IPAC) de l’Université Laval, avec le soutien du Centre de recherche Cultures – Arts – Sociétés (CELAT), l’événement se déroulera le mercredi 3 décembre, de 13 h à 19 h, à l’Espace Quatre Cents (salle 320), dans le Vieux-Port de Québec.
À la suite d’une conférence inaugurale de l’urbaniste émérite Serge Viau, une première table ronde visera à faire le bilan de cette inscription en présence de représentant-es des trois instances – municipale, provinciale et fédérale – qui gèrent le site. Une seconde table ronde, consacrée aux perspectives d’avenir, permettra d’aborder avec des expert-es quatre enjeux majeurs : la gestion du tourisme, la régénération du milieu de vie, la valorisation du patrimoine culturel immatériel et la transition écologique.
L’événement se conclura par le lancement de la version papier de l’Encyclopédie des patrimoines de l’Amérique française (Presses de l’Université Laval), un ouvrage unique dirigé par Laurier Turgeon (CELAT), Yves Bergeron (CELAT) et Martin Fournier, qui met en valeur les différentes formes du patrimoine (naturel, matériel et immatériel) des régions francophones de l’Amérique du Nord. Ce lancement est rendu possible grâce au soutien du CELAT, de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Laval, de l’IPAC, de l’Institut du patrimoine de l’UQAM, de l’OVPM et de la Commission de la mémoire franco-québécoise (CMFQ).
Bienvenue à tous et à toutes!
Inscription gratuite requise : https://forms.gle/FWmj32nSVpt9usjV9
PROGRAMME PROVISOIRE
12 h 45 Accueil
13 h Mots de bienvenue
• Laurier Turgeon, professeur d’histoire et d’ethnologie, Département des sciences historiques, Université Laval, et directeur de l’Institut du patrimoine culturel (IPAC)
• Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec-Centre (intervention vidéo)
• Bruno Marchand, maire de Québec, ou un-e représentant-e
• André Darveau, vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et aux finances, Université Laval
13 h 30 Conférence inaugurale
Animateur : Louis Vallée, président de la Fédération Histoire Québec
Conférencier : Serge Viau, urbaniste émérite et directeur de l’urbanisme de la Ville de Québec lors de son inscription sur la Liste du patrimoine mondial en 1985
« Québec, ville du patrimoine mondial : cette ville n’est surtout pas un musée; elle est vivante et adaptable »
14 h 10 Table ronde « Le bilan »
Animateur : Serge Filion, urbaniste, membre émérite de l’OUQ et fellow de l’Institut canadien des urbanistes
Intervenant-es :
• Jean-Jacques Adjizian, directeur général du patrimoine, ministère de la Culture et des Communications
• Michèle Leblond, directrice de l’Unité de gestion de Québec, Parcs Canada
• Chantale Émond, directrice de projets, Service de la culture et du patrimoine, Ville de Québec
Répondant-es : Elisabeth Comeau, candidate à la maîtrise en ethnologie et patrimoine, Université Laval, et Étienne Gagnon, doctorant en ethnologie et patrimoine, Université Laval
15 h 25 Pause santé
15 h 45 Table ronde « Les perspectives d’avenir »
Animateur : Alex Tremblay Lamarche, directeur général du Pôle culturel du monastère des Ursulines
Intervenant-es :
• Habib Saidi, professeur d’ethnologie, de muséologie et de tourisme culturel, Département des sciences historiques, Université Laval
• Guy Mercier, professeur de géographie humaine, Département de géographie, Université Laval
• Laurier Turgeon, professeur d’histoire et d’ethnologie, Département des sciences historiques, Université Laval, et directeur de l’IPAC
• Geneviève Cloutier, professeure à l’École d’aménagement du territoire et de développement régional et directrice adjointe du Centre de recherche en aménagement et développement (CRAD), Université Laval
Répondant-es : Emilie Gourbin, ancienne chargée de projets en patrimoine urbain à l’OVPM et diplômée de la maîtrise en ethnologie et patrimoine, Université Laval, et Nicolas Grenon-Simard, doctorant en ethnologie et patrimoine, Université Laval
17 h 30 Cocktail et lancement de l’Encyclopédie des patrimoines de l’Amérique française, dirigée par Laurier Turgeon, Yves Bergeron et Martin Fournier et publiée par les Presses de l’Université Laval et les Presses universitaires de Rennes.
Comité scientifique du colloque : Mikhaël De Thyse, secrétaire général de l’Organisation des villes du patrimoine mondial, Caroline Houde, directrice de la Division du patrimoine au Service de la culture et du patrimoine de la Ville de Québec, Éric Légaré-Roussin, président de la Société historique de Québec, et Laurier Turgeon, professeur titulaire au Département des sciences historiques de l’Université Laval et directeur de l’IPAC
ARGUMENTAIRE
Le 3 décembre 2025 marque le 40e anniversaire, jour pour jour, de l’inscription du site patrimonial du Vieux-Québec sur la Liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Ce vaste site de 135 hectares embrasse l’ensemble fortifié de la Haute-Ville et des parties de certains quartiers de la Basse-Ville, Cap-Blanc (à l’ouest) et Saint-Roch (au nord). Il comprend quelque 1400 bâtiments construits à partir du 17e siècle, 470 sites archéologiques et plusieurs biens patrimoniaux classés. Cet ensemble urbain bien préservé a été inscrit sur la prestigieuse liste de l’UNESCO en raison de sa valeur universelle exceptionnelle, soit parce qu’il représentait un exemple remarquable d’une ville coloniale fortifiée au nord du Mexique et le berceau de l’établissement français dans les Amériques.
Cet anniversaire nous invite à faire le bilan du chemin parcouru pendant ces 40 ans. Quelle a été l’incidence de l’inscription sur la préservation et la mise en valeur des bâtiments de ce site patrimonial ? Comment a-t-elle influencé le développement touristique et les résident-es? L’inscription a-elle contribué à un développement économique, social et culturel durable du Vieux-Québec? A-t-elle permis de régénérer l’environnement urbain ? La gestion tripartite du site – par les paliers municipal, provincial et fédéral – ne rend-t-elle pas la prise de décisions complexe? Nous avons invité les trois instances qui gèrent le site, soit des représentant-es de la Ville, du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral, à nous en parler.
Il s’agira surtout d’envisager les perspectives d’avenir en se penchant sur les enjeux actuels et futurs. Comment peut-on faire de ce site patrimonial un laboratoire et un modèle de bonnes pratiques en matière de gestion pour l’ensemble de la Ville et pour d’autres villes du Québec et d’ailleurs? Nous avons identifié quatre défis majeurs auxquels le site patrimonial devra faire face dans les prochaines années. Le premier est la gestion du tourisme. La Ville de Québec reçoit actuellement entre 7 et 8 millions de touristes par année. Selon l’Organisation mondiale du tourisme, la pratique touristique continuera à augmenter dans les prochaines années, et pourrait même doubler d’ici 2035. Comme beaucoup de villes patrimoniales, Québec devra faire face à cette croissance importante du tourisme qui met déjà des pressions sur les infrastructures d’accueil, sur les transports urbains et sur les résident-es. Ne faudra-t-il pas développer un plan stratégique pour gérer cet accroissement des flux touristiques ? Le deuxième défi est l’amélioration de l’habitabilité et la régénération du milieu de vie pour préserver l’intégrité du site tout en retenant les résident-es. Le Vieux-Québec connaît un exode de ses habitant-es depuis plusieurs années. Ce mouvement se poursuit. De 2016 à 2022, le Vieux-Québec a encore perdu 8 % de ses résident-es. Comment faire pour que le site patrimonial soit un milieu de vie attrayant, habité par des résident-es à l’année? Le troisième défi porte sur la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel. Les interventions de conservation et de mise en valeur du site ont porté jusqu’à présent essentiellement sur le patrimoine matériel, soit les bâtiments et les sites archéologiques, mais très peu sur le patrimoine vivant. Or, le Vieux-Québec renferme aussi un riche patrimoine immatériel composé de savoir-faire traditionnels de restauration d’immeubles historiques, de métiers artisanaux, de traditions orales et d’arts du spectacle. ICOMOS a adopté en 2024 une charte visant à tenir compte du patrimoine culturel immatériel dans la gestion des sites du patrimoine mondial. Une meilleure sauvegarde et mise en valeur de ce patrimoine immatériel ne pourra-t-elle pas contribuer à valoriser l’habitabilité, à régénérer le milieu de vie et à mieux préserver l’esprit du lieu? Le quatrième défi est celui de la transition écologique. Si le site bénéficie de plusieurs espaces verts et n’a pas été beaucoup menacé jusqu’à présent par les changements climatiques, il ne sera pas épargné dans les prochaines années. Avec une montée prévue du niveau des océans d’environ 50 cm d’ici 2050, des parties de la Basse-Ville risquent d’être inondées dans un avenir rapproché. L’augmentation du tourisme risque d’accroître l’empreinte de carbone. Le site ne devrait-il pas s’inspirer davantage du Document d’orientation sur l’action climatique pour le patrimoine mondial de l’UNESCO? Ne faut-il pas envisager un plan stratégique d’aménagement pour composer avec les inondations et de décarbonisation pour assurer le développement durable du site?
PRÉSENTATION DES INTERVENANT-ES
CONFÉRENCIER
Architecte retraité et urbaniste émérite, Serge Viau est consultant privé pendant une quinzaine d’années, puis oeuvre à la Ville de Québec pendant 28 ans à plusieurs postes de direction, dont celui de directeur général. Il contribue à l’inscription de l’arrondissement historique de Québec sur la Liste du patrimoine mondial et à l’établissement à Québec du siège de l’Organisation des villes du patrimoine mondial. Il participe à plusieurs missions du Conseil de l’Europe. Il est l’auteur de quelques livres sur le patrimoine. Entre autres distinctions, il est récipiendaire du prix Robert-Lionel-Séguin en 2012 et il a été reçu en 2018 officier de l’Ordre national du Québec.
PANÉLISTES
Jean-Jacques Adjizian est actuellement directeur général du patrimoine au ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il a préalablement occupé plusieurs fonctions au sein de ce même ministère, notamment celles de directeur des politiques et des relations interministérielles, directeur du numérique, des médias et des communications et directeur de l’archéologie et des relations avec les Premières Nations et Inuit. Il est détenteur d’une maîtrise en archéologie et a œuvré comme archéologue dans différents contextes de développement régional.
Geneviève Cloutier est professeure à l’École d’aménagement du territoire et de développement régional et directrice adjointe du Centre de recherche en aménagement et développement (CRAD) de l’Université Laval. Elle s’intéresse à l’évolution des pratiques d’aménagement et à la transformation des espaces pour faire face aux défis sociaux et climatiques. Ses recherches portent sur l’engagement local, la participation et analysent la portée des initiatives citoyennes locales. Elle est aussi membre de l’Ordre des urbanistes du Québec.
Guy Mercier est, depuis 1992, professeur de géographie de l’Université Laval de Québec, où il a par ailleurs occupé diverses fonctions de gestion. Ses recherches couvrent trois champs : l’histoire et l’épistémologie de la géographie; les études urbaines et aménagistes; la géographie du paysage, du patrimoine et de l’art public. Il prépare actuellement, avec Yves Brousseau, un atlas général du Québec. Parmi ses contributions, on compte la mise sur pied, avec Vincent Berdoulay, de l’Association internationale de géographie francophone, dont le deuxième congrès aura lieu à Dakar en 2026.
Habib Saidi est professeur titulaire d’ethnologie, de muséologie et de tourisme culturel à l’Université Laval et membre du CELAT et de l’IPAC. Ses recherches portent sur l’étude du trinôme patrimoine/tourisme/musée, plus précisément sur les politiques et les poétiques de la patrimonialisation, de la muséalisation et de la mise en tourisme. Il mène des recherches comparatives sur les dynamiques patrimoniales et touristiques dans diverses villes d’Amérique du Nord et de la Méditerranée. Après avoir étudié Québec et Tunis comme capitales patrimoniales et touristiques, il s’est intéressé à l’over-tourisme et à la gentrification à Barcelone et Montréal, ainsi qu’au patrimoine partagé au Québec, en Espagne, en Tunisie et au Maroc. En 2019, il a fondé l’Unité mixte de recherche Capitales et patrimoines (UMRcp), consacrée à l’étude et à la mise en valeur du site patrimonial Cartier-Roberval à Québec.
Laurier Turgeon est professeur titulaire au Département des sciences historiques de l’Université Laval. Il est directeur de l’Institut du patrimoine culturel (IPAC), directeur du Laboratoire d’enquête ethnologique et multimédia (LEEM) et directeur du baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales (BISHEP). Il est l’ancien titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique (2003-2017), président sortant du Forum des ONG accréditées à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, et rédacteur en chef de la revue Ethnologies. Au fil de sa carrière, il s’est intéressé aux relations entre les populations autochtones et les Français à l’époque coloniale, s’est penché sur la construction sociale du patrimoine dans des contextes interculturels, avant de mobiliser de nouvelles technologies numériques dans la conservation et la mise en valeur des patrimoines. Il a remporté le prestigieux prix Acfas André-Laurendeau 2022.
RÉPONDANT-ES
Elisabeth Comeau est détentrice d’un baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales (BISHEP) et d’un certificat en archivistique à l’Université Laval. Récipiendaire d’une bourse d’études supérieures du Canada du CRSH et du Prix des sciences historiques, elle débute à l’automne 2025 une maîtrise en ethnologie et patrimoine, sous la direction du professeur Laurier Turgeon. Elle s’intéresse notamment à la considération du patrimoine culturel immatériel comme un agent actif au service du développement durable au Québec. Elle occupe des emplois qui l’ont menée à travailler dans des domaines touchant l’archivistique, le patrimoine culturel et le patrimoine bâti. Elle est membre étudiante du CELAT et de l’IPAC.
Détenteur de baccalauréats en traduction et en sciences historiques et études patrimoniales, Étienne Gagnon s’intéresse vivement au patrimoine comme espace de dialogue et de rencontre de l’altérité. C’est cet intérêt qui a justifié son entrée dans l’Unité mixte de recherche Capitales et patrimoines (UMRcp), et qui l’amène actuellement à poursuivre des études doctorales, sous la direction de Habib Saidi, sur la patrimonialisation du site Cartier-Roberval, à Cap-Rouge (Québec). Son projet de thèse, intitulé « Le patrimoine, un exercice commun? Une étude de la patrimonialisation du site Cartier-Roberval à travers la vision de ses acteurs », vise d’une part à développer les réflexions sur les mises en application des pratiques exemplaires de la patrimonialisation (notamment, la concertation et la participation des communautés, groupes et individus à un niveau local) dans des projets concrets. D’autre part, il s’interroge sur la capacité de projets patrimoniaux à rassembler ses parties prenantes et leurs discours, plutôt qu’à les opposer.
Emilie Gourbin est titulaire d’un master Erasmus Mundus tridiplômant en patrimoine et développement des territoires, qui l’a amenée à fréquenter les universités de Budapest, Catane ainsi que l’Université Laval. Elle a concentré sa recherche de maîtrise sur la redéfinition inclusive et durable du centre historique du Vieux-Québec, puis a travaillé deux ans à l’OVPM en tant que chargée de projets en patrimoine urbain, où elle a accompagné les villes membres de l’Organisation dans leur collaboration autour de questions d’urbanisme durable et de qualité de vie citoyenne en centre-ville historique classé à l’UNESCO.
Nicolas Grenon-Simard est candidat au doctorat en ethnologie et patrimoine à l’Université Laval. Détenteur d’un baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales (BISHEP) et d’une maîtrise en ethnologie et patrimoine, il étudie le rôle social des musées québécois et la réactualisation des discours sur des collections patrimoniales à l’aune des préoccupations et des changements sociopolitiques contemporains. Il est également chargé de projet à l’Îlot des Palais et travaille sur divers projets de mise en valeur du patrimoine urbain de la ville de Québec.